Revue Ecrire l’Histoire
Écrire l’histoire est une revue annuelle publiée avec le concours de CERILAC par CNRS Éditions et en ligne sur OpenEdition : https://journals.openedition.org/elh/
La revue entend être un espace de confluences des histoires de l’histoire, des historiographies, et de toutes les pratiques symboliques qui prennent l’histoire pour matériau. La revue fait se rencontrer des manières de représenter l’histoire d’ici ou d’ailleurs, d’aujourd’hui ou d’autrefois ; des manières aussi de se servir de l’histoire, à un moment où, dans la société obsédée de patrimoine et de mémoire qui est la nôtre, ces fonctions et ces usages demandent à être réfléchis et situés dans le temps long des transformations matérielles, sociales, anthropologiques, éthiques et politiques. Elle veut être le lieu d’interrogations réciproques de l’histoire, de la littérature, et de l’esthétique – trop souvent encore enfermées en elles-mêmes, et qui ont pourtant tout à gagner à travailler ensemble.
Fondée par Claude Millet et Paule Petitier en 2008, la revue est dirigée depuis 2020 par Florence Lotterie (littérature, CERILAC) et Fabien Simon (Histoire, ECHELLES)
Depuis son entrée dans le programme FREEMIUM d’OpenEdition en 2024, la revue est passée intégralement en ligne, où l’ensemble de ses contenus est désormais accessible dès le dernier numéro paru (2025).
Derniers numéros parus
- Raconter des H/histoires. En écrivant, en filmant, sous la direction de Frédérique Berthet et Jacques-David Ebguy (2025)
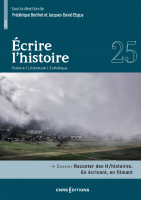
Le paysage intellectuel, sensible et artistique sur lequel s’inscrit ce numéro d’Écrire l’Histoire est celui d’un temps qui a de nouveau fait du récit, factuel ou fictionnel, la forme dominante de l’Histoire. On ne compte plus les publications qui examinent et rapprochent les formes d’intelligibilité déployées pour comprendre les phénomènes historiques et celles qui permettent de construire des histoires. Histoire des autres, d’un autre ou « ego-histoire » : l’injonction à raconter se fait entendre. Non sans susciter critiques et polémiques, certains historiens ne sont-ils pas allés jusqu’à prôner une forme d’effacement des frontières entre les disciplines et les pratiques ? Réciproquement, les créations artistiques les plus diverses (théâtre, bande-dessinée, art contemporain, etc.), et tout particulièrement la littérature et le cinéma, n’ont cessé, à travers de nouvelles manières de raconter des histoires, d’agencer des « fictions », de délimiter les terrains de leurs « actions », d’élire des actrices/des acteurs, de mettre en scène des évènements, de choisir des itinéraires descriptifs, d’emprunter, et de jouer, avec le vocabulaire, les problématiques et les méthodes de l’Histoire, pour proposer une saisie singulière de celle-ci, de son mouvement, de son (absence de) sens, de ses traces et de ses effets. Aussi a-t-on voulu en ces pages, plutôt que de revenir sur les questions de frontières disciplinaires et leurs brouillages, examiner précisément les formes que prennent ces mises en récit de l’Histoire – autrement dit, ces voies expressives.
Quelles histoires les « conteurs » de l’Histoire inventent-ils en écrivant, en filmant ? Que font les histoires à l’Histoire ? : c’est à ces deux questions, entremêlées, que se consacre ce dossier, en circulant entre le discours historique et les pratiques artistiques, en examinant les rapports entre démarches et « disciplines » – que ce soit sur le mode de l’innutrition, de la greffe, de l’inspiration, du croisement, de l’appropriation, de la subversion ou de l’infraction.
- Nos mémoires. Écrits de soi, histoire et politique aujourd’hui, sous la direction de Clarisse Berthezène et Jean-Louis Jeannelle (2024)

- Le carambolage des temps, sous la direction de Mélanie Henry et Sophie Wahnich (2023)

- Chanson, histoire, mémoire, sous la direction de Jean Vignes, Tatiana Debbagi Baranova et Paule Petitier (2022)

- Les mots du genre, sous la direction de Anaïs Albert, Patrick Farges et Florence Lotterie (2020-21)

- L’historien et les langues, sous la direction de Paule Petitier et Fabien Simon (2019)

À lire aussi

Soutenance HDR – « Écosystèmes de l’idée documentaire : le direct et le local » – Caroline Zéau
Nous avons le plaisir de vous annoncer la soutenance de l'habilitation à diriger des recherches de Mme Caroline Zéau le samedi 7 février prochain à 14h Titre de l'HDR Écosystèmes de l’idée documentaire : le direct et le local Jury HDRCécile Sorin, Professeure en...

Rencontre « Le Style de Marx » – Vincent Berthelier
© Tous droits réservés Nous vous convions à la prochaine rencontre de l'axe "Écrire et penser avec l'histoire", qui aura lieu le mardi 3 février de 17h à 19h dans la bibliothèque Jacques Seebacher: Vincent Berthelier viendra nous présenter son dernier livre, Le Style...

Poussières de sens
Parution de l'oeuvre Poussière de sens de Hala Habache dans la collection Levée d'ancre de l'éditeur l'Harmattan en date du 28/08/2025 l’écriture, partie indissociable de ce corpsl’acte d’écrire comme réaction physiqueécrire pour oublierces déclinaisons de la peur...

AAC JE doctorale – « “L’artiste en sa société : pour un réexamen de la figure de l’artiste engagé”
Journées d’études organisées par Nicolas Chapeau, Romain Charbonnier, Clément Gréau, Alice Grossi, Hala Habache, Justine Michon, Eveline Su.Date : mercredi 17 juin 2025. Lieu : Grands Moulins, Université Paris-Cité Modalités Les propositions ne...
